|
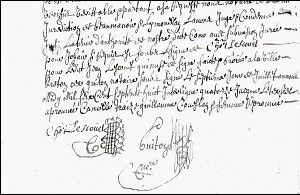
Document
dans lequel apparaît la signature de Maître Guitton ainsi qu’une référence
à la Ville Breton.
« Maître
Laurens Guitton, âgé de 80 ans, inhumé le 26 juin 1706 en présence
de Marie, Thérèse,Guillaume, Jean, Jeanne et Simone ses enfants »
.
Maître Laurens Guitton était notaire à la seigneurie de
Beaumanoir-Limoëlan, il tenait ses audiences à la Ville Breton.

Office
de notaire sous l’Ancien Régime.
|
|
LES
NOTAIRES DE CAMPAGNES SOUS L’ANCIEN REGIME
A
une époque où très peu de gens savaient lire et écrire, le
notaire de campagne jouait sous l’Ancien Régime un rôle
primordial.
Première
marche de l’ascension sociale d’un paysan aisé,
le notaire seigneurial était désigné par le seigneur ayant
droit de justice.
Ces
notaires étaient près de 4.000
à la veille de la Révolution, leur surnombre fut
au demeurant à l’origine de plaintes dans certains cahiers de
doléances.
Placé
dès l’âge de 10 ans chez un notaire, l’enfant débute en recopiant
les actes et les documents juridiques, tandis que leurs aînés
apprennent l’art de la calligraphie.
Selon
Yvonne Henry auteur d’une remarquable étude parue dans le
bulletin généalogiques des Côtes d’Armor n°39 ; les
postulants devaient d’abord exercer les fonctions de greffiers, et
acquérir de solides bases de calcul.
Après
avoir passé cinq ans dans une étude, et obtenu un examen professionnel
devant la Communauté des notaires, l’aspirant devait être
âgé d’au moins 25 ans, et être de confession catholique, le prêtre
délivrait l’attestation.
Après
quoi, le jeune homme prêtait serment main levée devant le représentant
du Roi, de l’église et
de la profession « Promettre et jurer à Dieu d’en bien fidèlement
servir à l’avenir. »
Au
cas où il n’appartenait pas lui-même à une famille de notaires, il
devait débourser une somme d’argent importante afin d’obtenir une
office, en revanche, s’il était fils ou neveu de notaire, cette
office était gratuite.
|
|
LES
PUITS
L'homme
a creusé des puits très tôt, puisque l'on retrouve, sur l'Indus, les
traces de puits d'alimentation en eau datant du VIe millénaire av.
J.-C. généralement circulaire et muraillé, creusé dans la terre pour
atteindre la nappe aquifère la plus proche de la surface (nappe libre
ou nappe phréatique).
C’est
très probablement un sourcier qui
décidait l’emplacement du puits dont la profondeur variait de
3 à 4 mètres et plus. Certains puits présentent divers types
de margelles, et comme ici
à la Ville-Breton, ils peuvent être insérés dans un bâtiment. (voir
aussi La Vieille-Porte et Bourgueneuf)
« François
Robert, âgé de 60 ans, décédé dans un puits à la Ville-Breton,
inhumé à Sévignac le 4 décembre 1712 en présence de Gilles
Renouard, Guillaume Guitton, et Amaury Réhel ».
|
|

Vieux
puits à la Ville-Breton
|