|
|
|
|
par Michel Lescouët |
|

|
|
|
|
|
Dans
la revue « ANNALES DE BRETAGNE » en 1951,
le Bassin de Broons
fit l’objet d’une étude à travers un article
signé Jean Lallinec. En voici le contenu :
Le
tracé hydrographique donne un certain poids à cette hypothèse. Le coude
de la Rosette au droit de Mégrit peut aussi bien être dû à u abrupt de
faille ayant guidé le tracé, qu’à l’influence d’un massif de
roches dures. Mais c’est surtout l’extraordinaire parallélisme des
rivières orientées SW-NE sans équivalent dans les régions
avoisinantes, qui a retenu l’attention. Logiquement on est amené à la
conclusion que l’évolution des
cours d’eau du Bassin de Broons s’est
faite dans des conditions différentes des plateaux voisins. Un
accroissement de pente brusque dû à cet effondrement le long d’une
faille ou d’une flexure nous paraît être la meilleure explication de
cette jeunesse dans le tracé qui n’a pas été conservés ailleurs. Si
on essaie de reconstituer l’histoire de ce réseau hydrographique on est
amené à prendre comme point de départ la pénéplaine à l’époque éocène.
Des mouvements du sol créèrent sur cette surface des ondulations dans
les creux desquelles s’installèrent les principaux cours d’eau. Quels
étaient ils ? On ne peut être affirmatif que pour l’un d’eux :
la Rance. Le fait que les dépôts miocènes sont limités à sa vallée,
indique qu’elle était creusée dès cette époque. Peut être la
Rosette et l’Arguenon datent ils de la même époque. Selon M. Barrois
en effet, les rivières coulant du S-O au N-E se rattachent à un système
de drainage ancien, dépendant du premier mouvement des vallées à l’époque
tertiaire. Le creusement de la vallée de la Rance fut arrêté par
l’invasion de la mer des faluns. Après le retrait de cette mer, la
Rance retrouva en grande partie son ancien cours puisque les dépôts miocènes
sont localisés dans l’actuelle vallée.
Au
pliocène l’arrêt de l’érosion dû être général. Si l’on admet
que l’élévation des eaux de la mer atteint à cette époque 110
mètres, seule une petite partie de la butte de Broons émergeait. Sur
cette couverture sédimentaire en pente vers la Manche s’est établi un
nouveau réseau hydrographique dont dérive directement le réseau actuel.
Les rivières ont déblayé les sables et les graviers dont il ne reste
que des témoins, exhumant l’ancien relief. Au cours de ce creusement la
Rance a retrouvé ses anciennes vallées pré pliocène et pré oligocène :
Rance, Rosette, Rosaie, Rieulle, Arguenon développaient de larges vallées
dans les sables et les graviers puis dans les schistes, tandis qu’elles
sciaient d’étroites gorges dans les roches dures limitant le bassin
au Sud et à l’Est. Au total depuis l’éocène, au moins deux réseaux
hydrographiques
se sont succédés : l’un post-éocène, l’autre
post-pliocène (trois dans le bassin de la Rance : post-éocène,
post-miocène,
post-pliocène). Il semble d’après l’exemple de la Rance que
les cours d’eau principaux aient retrouvé lors d’un nouveau
creusement, des tracés plus anciens ; autrement dit que la
disposition orographique actuelle était déjà tracée à l’époque
miocène. Évidemment il s’est produit quelques modifications de détail.
Les cours actuels ne sont pas exactement calqués sur les cours plus
anciens. Certaines déviations ont laissé des traces dans la topographie
et on peut approximativement reconstituer d’anciens tracés. Les
exemples les plus nets sont offerts par la Rance et son affluent le Frémeur.
C’est peu de chose au total. Le réseau est resté à peu près tel
qu’il s’était constitué sur la pénéplaine
éogèné. Même l’invasion
de la mer au pliocène n’a apporté que des modifications de peu
d’ampleur. Probablement parce que les conditions générales de pente
ont été peu troublées par le dépôt des sables et graviers. Tout au
plus ont-ils masqué quelques accidents du relief et ainsi permis de légères
surimpositions : celle de la Rance dans le massif granitique de Guitté
date vraisemblablement de cette époque.
La topographie de l’intérieur
du Bassin est essentiellement et directement l’œuvre des cours d’eau.
C’est avant tout un relief en creux. L’exemple se présente comme une
vaste surface plane se tenant vers 70-80 mètres découpée en plateaux
allongés par de nombreuses vallées très évasées dans leur cours supérieur,
plus encaissées avec des méandres dans leur cours inférieur. Seule la
butte qui porte la petite ville de Broons vient rompre cette monotonie.
Cette butte, de forme grossièrement elliptique, mesure à peu près
quatre kilomètres dans sa plus grande dimension avec une
largeur variant de un à deux kilomètres. La route nationale de
Rennes à Brest qui la traverse suivant son axe principal y accède par
deux fortes rampes, l’une à l’Ouest à l’entrée même de Broons,
l’autre à l’Est près du village les Touches. La surface est
nettement moins régulière que celle des plateaux qu’elle domine. En
particulier un monticule qui culmine à 113 mètres prend dans cette région
de morne relief une allure de petite colline. Rechercher l’explication
de la présence de cette butte amène tout d’abord à imaginer l’évolution
morphologique de toute la région. Selon nous on peut la résumer comme
suit. Le point de départ est ici encore la pénéplaine éogène. Sur
cette surface il y a eu tendance à la formation de cours d’eau adaptés
dans leur tracé à l’orientation des couches.
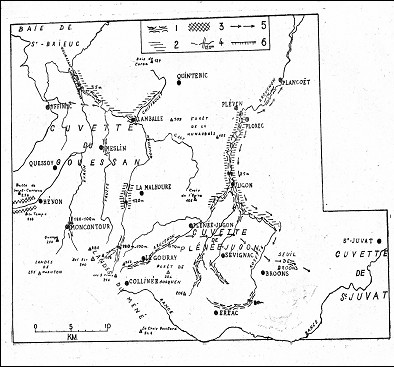
L’un
d’eux, prolongeant de la Rosette supérieure coulant vers le Nord-Ouest
a déblayé une large
dépression dans les schistes tendres
(dépression de Sévignac) mettant par opposition en relief les grès
et les schistes siluriens et carbonifériens du synclinal primaire. Ce déblaiement
n’affectait que peu la région de Broons dont les sous sol fût rendu résistant
par les nombreux filons de diabase qui le traversent. Elle formait ainsi
une butte. A cette époque seule donc la partie méridionale de la région
était excavée. Ultérieurement, vers le milieu du tertiaire, ou plus improbablement
à la fin (post-pliocène) le rejeu de la faille Mégrit-Yvignac
avait pour conséquence l’effondrement de la partie septentrionale.
Ainsi la dépression d’érosion
différentielle précédemment formée au contact des couches dures
du synclinal primaire se doublait vers le Nord d’une zone déprimée techniquement.
La formation du bassin de Broons était achevée.
|
|
|
|
|
LA
RIEULE
Cette
rivière qui sert de limite naturelle entre Sévignac et Plénée prend sa
source à l’étang du Poncelet , elle
se jette ensuite dans l’étang de la Rieule, puis devient
ruisseau du moulin de la Rieule, elle est successivement enjambée par les
Ponts-Neufs situés en dessous du Gué Noir , de la Rochelle, du Bordage,
du Glavet et du Clos Bastard.
|
|

|
|
|
|
|

|
|
LA ROSAIE
(Endroit
où poussent les roseaux)
Cette
rivière prend sa source au ruisseau du Glais en dessous de Frilouze, puis
elle devient le ruisseau de la Mare aux Pas.
Enjambée par le Pont-Fouchet,
le Pont des Maffrais et le Gué en Rouillac, elle passe ensuite sous le
Pont-Rouxel et se jette dans l’étang de Rochereuil.
Elle est franchie ensuite par les ponts de Cachegrain et Milaouai,
devenue ruisseau de la Ville es Blancs dans le cadastre de 1830,
elle s’écoule sous
le pont des Salles, devient
ruisseau du Moulin de la Rosaie, rencontre le Pont aux Moines, puis le
Pont-Josse entre Sévignac et Dolo dit aussi pont des trois rochers, elle
franchi le pont Hamon et se jette selon l’expression « dans
les écouailles du Grand étang de Jugon. »
|
|
|
|
|
LA
ROSETTE
(Tire
son nom d’une des branches principales du Nil)
La
Rosette prend sa source au Bois Jamet en Eréac, ainsi qu’au ruisseau
Leglais en dessous du bois de la Crânne.
Devenue Rosette, cette rivière
franchi les ponts suivants : des demoiselles à Brondineuf, de la
Normandais entre Sévignac et Broons, Pont-Plisson entre Sévignac et
Broons, enfin au Pont du Château tout près de la colonne du-Guesclin.
|
|

|
|
|
|
|
LA
MARE DE LA DAVIETTE
Aujourd’hui
asséchée ce lieu se situe entre le Grand Kerbras et la Vieille Porte.
Enjambée par le Pont-Besnard, il devient ruisseau du Pont-Besnard, puis ce ruisseau s’écoule sous le Pont-Gicquel où il devient ruisseau du
Pont-Gicquel, il devient Mare aux divisions et ruisseau de la
Mare aux divisions, enjambé par le Pont des Bardiaux en Trémeur,
il est nommé ruisseau du Pont
des Bardiaux, il s’écoule
sous le Pont nommé Là où il y a situé en dessous du Quinier.
Citons
aussi le ruisseau du chemin du Vieux-Puits à Quihériac et celui de la
Touche Margaro qui s’écoule entre les Roses et la Béchardière et s’étire
ensuite par la Bichonnais.
|
|
Citons
aussi le ruisseau du chemin du Vieux-Puits à Quihériac et celui de la
Touche Margaro qui s’écoule entre les Roses et la Béchardière et s’étire
ensuite par la Bichonnais. |
|
|
|
|
|
|
|