| Ce
rocher à présent
masqué par une pépinière attira à la fin des années 1950
l’attention d’un géologue. Une parcelle voisine
porte le nom de Marbara, une autre les Gaules. |
|

|
|
|
|
|
|
Le
rocher de Mémentü conserve des traces du plissement
Hercynien, terme bien barbare sous lequel se cache les
mouvements géologiques qui engendrèrent l’émergence des
massifs primitifs, puis leur érosion voici près de 300
millions d’années.
Le
Massif Armoricain, était l’un de ces massifs, il s’étirait
depuis le bocage vendéen
jusqu’à la Normandie et passait par le centre de
notre péninsule.
Ce
massif ancien s’élevait alors à une altitude comprise
entre 3000 & 4000 mètres
alors qu’il ne dépasse guère les 300 mètres
aujourd’hui.
|
|

|
|
|
|
ETUDES
GEOLOGIQUES
Dans
la revue « ANNALES
DE BRETAGNE »
en 1951, le Bassin de Broons fit l’objet d’une étude à travers un
article signé Jean
Lallenec. En voici le contenu :
« Le
bassin de Broons est l’un des trois bassins qui se succèdent sur un même
axe prolongeant le bord ouest de la baie de Saint-Brieuc ; le
bassin de Lamballe et le bassin de Rennes l’encadrent au Nord-ouest et
au Sud-est ;
Ayant la forme d’un parallélogramme assez régulier,
il s’étend de l’Arguenon à la Rance sur une vingtaine de kilomètres
et des hauteurs de Rouillac-Saint Jouan de L’Isle au plateau de Mégrit-Yvignac
sur neuf kilomètres.
La dénomination bassin de Broons, bien qu’elle
ne soit pas entrée dans le langage populaire, couvre une réalité
tangible. Le plateau de Mégrit qui ferme le bassin vers le
Nord se tient vers 90.110 mètres, dominant la région de Trémeur-Trédias,
d’une trentaine de mètres en moyenne ; au Sud, la différence
d’altitude est encore plus sensible ; Sévignac est à 70
mètres, alors que les hauteurs qui constituent la limite Sud atteignent
140 mètres et exceptionnellement 150 mètres ; vers l’Ouest et
vers l’Est les dénivellations sont presque aussi nettes : sur la
rive gauche de l’Arguenon
le plateau est à 100-110 mètres, sur la rive droite il ne dépasse
guère 80 mètres. Guenroc sur la bordure orientale est à 96 mètres,
le bassin, au pied, ne dépasse pas 62 mètres.
Ainsi, entouré de
toutes parts par des plateaux compris entre 90 mètres et 150 mètres,
le petit pays de Broons est bien une zone déprimée.
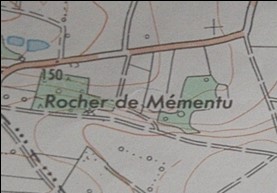
Quelle
est l’origine de ce bassin ?
La
géologie suggère une première réponse : le bassin constitué
essentiellement par des phyllades de St-Lô (X) schistes précambriens
friables et tendres, et entourés de roches dures : grès des
hauteurs appalachiennes du Sud, granite et quartzite du massif de Guitté,
granulite du plateau de Mégrit, serait le résultat d’un déblaiement
des assises tendres par l’érosion. Ce serait une simple excavation
d’érosion différentielle.
Pourtant cette explication dont le
plus grand mérite est la simplicité, ne satisfait pas entièrement
l’esprit.
La partie méridionale du bassin est incontestablement l’œuvre
de l’érosion : le talus raide qui monte vers les hauteurs pénéplaines
du synclinorium médian suit exactement les affleurements de grès
armoricain, roche dure de ce synclinal. Il faut donc convenir que
c’est l’opposition entre
les roches dures du synclinal silurien et les schistes briovériens
tendres, qui est responsable de la différence d’altitude. Mais au
Nord le problème est plus complexe.
Pour M. Dobet, qui avant nous,
avait étudié cette région, l’abrupt de Jugon et d’Yvignac qui
limite le bassin de Broons au Nord, est dû à l’érosion différentielle ;
c’est une « côte » dit-il ; on dirait aujourd’hui
avec M. Guilcher une «pseudo cuesta » .
L’abrupt
en question a bien,
par endroits tout au moins, l’apparence d’une
«pseudo cuesta ». Une rivière, la Rosette, la suit sur la
moitié de la longueur environ, de Mégrit à Jugon. Dans cette partie
abrupte suit à peu près le contact entre le briovérien et la
granulite : c’est ce qui a déterminé le conclusion de M. Dobet.
Est-ce
suffisant ? Au-delà de Mégrit vers l’Est, l’abrupt précédent
se continue sans qu’on puisse l’imputer cette fois à l’érosion
différentielle : ainsi au Nord du bourg de Trédias, on passe
brusquement d’un plateau situéde 70 mètres à un autre plateau situé
à 90 mètres d’altitude tous deux constitués des mêmes schistes
briovériens. Plus loin vers l’Est, pendant plusieurs kilomètres, on
n’observe plus aucune forte dénivellation. Cependant les courbes de
niveau apparaissent orientées exactement dans la même direction que
l’abrupt et des coupes révèlent un relèvement assez rapide de la
surface vers le Nord.
Vers
Yvignac l’abrupt réapparait toujours orienté
N
O-S E et en prolongement des sections précédentes. Il est vrai qu’il
y a là un petit noyau granulitique. Mais il ne se traduit par ailleurs
nullement sans la topographie. Au contraire,
au Nord d’Yvignac les points les plus hauts sont dans les
schistes briovériens : 118 mètres entre Lannouée et Couacler. A
environ trois kilomètres au S E d’Yvignac l’abrupt N O-S E cesse
d’apparaître dans la topographie. Depuis cet endroit jusqu ‘aux
hauteurs de Guenroc le bassin de Broons est ouvert sur le bassin de
Saint-Juvat-Le Quiou.
Cet abrupt Jugon-Mégrit-Yvignac se retrouvant après
des interruptions ou des atténuations et les différents tronçons étaient
toujours alignés, séparant des plates-formes
d’altitudes différentes et pourtant souvent constituées par
les mêmes roches, nous croyons qu’il s’agit d’un accident
tectonique, allant de la flexure à la faille suivant les points.
Sa direction N O-S E alors que les bandes de roches dures :
granulite et schistes micacés et feldspathiques, sont franchement E. O. ,
ajoute à notre conviction
La
direction armoricaine de cet accident fait penser qu’il s’agit
d’une faille hercynienne ayant rejoué vers le milieu du
tertiaire ou plus tardivement peut être : les géologues bretons
croient aujourd’hui à des mouvements post-pliocènes d’une ampleur
voisine de 20 mètres, c'est-à-dire de l’ordre de la différence
d’altitude entre le plateau de Mégrit et le bassin de Broons.
Si
l’hypothèse que nous venons de formuler au sujet de l’origine de
l’abrupt Jugon-Mégrit-Yvignac est exacte, le Bassin de Broons dans sa
partie septentrionale est non pas le résultat d’un déblaiement de sédiments
tendres mais celui d’un affaissement : c’est un bassin
tectonique.
|

LE
BASSIN DE BROONS
|
|
1)
Abrupt tectonique
2)
Flexure
3)
Vallées encaissées
4)
Fracture limitant au Sud la partie effondrée du bassin
4-bis)
Anciens écoulements
5)
Filons de diabase de la butte de Broons
6)
Limite des massifs granulitiques
7)
Plateaux plus élevés que le bassin
8 et 9) Rebords de roches dures
|
|
|
|
|
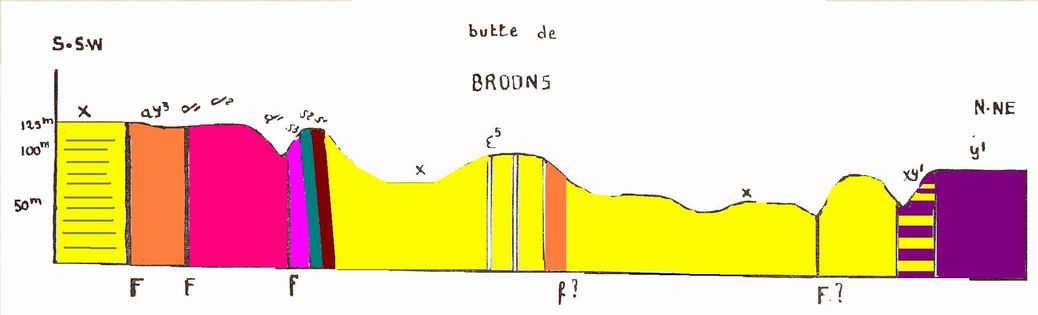
COUPE
À TRAVERS LE BASSIN DE BROONS
| Abreviations |
|
B :
Broons
C :
Caulnes
D :
Guenroc
M :
Mégrit
P
: Plénée-Jugon
S
: Sévignac
Tr :Trémeur
Ts :Trédias
Y
:Yvignac
|
ay3)
porphyroïdes
d2)
schistes et calcaires de Né hou
D’
) grès de Gard
s3)
grès de St Germain S.Ille
s2)
schistes d’Angers
s1)
grès armoricain
x)
phyllades de St-Lô
|
xy1)
schistes micacès
et feldspathisés
y1)
granulite
es)
disabase
f)
faille
f ?)
faille supposée
f ?)
fracture supposée
|
|
|
|
|
|
|
|
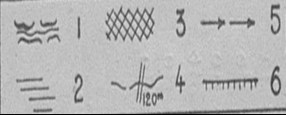
|
|
1)
vallée encaissée
2)
replats
3)
hauts replats
4)
ruptures de pentes
5)
écoulements anciens
6)
faille
|
|
|
|
Si
de cette étude morphologique on devait retenir quelque chose, il me
semble qu’il faudrait en premier lieu noter qu’après d’autres
travaux, elle aura attiré l’attention sur le rôle qu’à joué la
tectonique dans l’agencement du relief de la Bretagne, alors
que jusqu’à une époque récente on avait par trop sacrifié aux
surfaces d’érosion.
En second lieu, elle aura établi, croyons nous,
que le diabase peut dans certains cas se comporter en roche dure. Se référant
aux rivages, où l’on voit cette roche donner invariablement des
creux, beaucoup de géographes niaient que ses filons puissent être à
l’origine de la conservation de certains reliefs.
Dans le cas
particulier de la butte de Broons le contour de la hauteur et celui de
la zone de forte densité des filons de diabase coïncidant si nettement
qu’il est impossible de ne pas en être frappé. Il semble donc que
l’on soit fondé de conclure que, dans des roches tendres, les filons
de diabase nombreux et resserrés constituent une véritable armature
responsable de la résistance de l’ensemble. »
|
|
|
|

Une ancienne
carrière à Mémentü
|
|
Au
chemin des roches à Quévert , des échantillons sont regroupés
par grandes familles de roches dont le mode de formation et l'âge
sont donnés sur des panneaux à l'entrée du chemin: les
roches sédimentaires avec les conglomérats d'Erquy-Fréhel,
les grès briovériens de Guilliers, les grès armoricains de
Mûr-de-Bretagne, les grès roses d'Erquy, les schistes briovériens
de Guilliers, les schistes rouges de Pont-Réan, les schistes
bleus de Sévignac, les schistes noirs de Maël-Carhaix, les
calcaires coquilliers (faluns) de Tréfumel; les roches métamorphiques
avec les cornéennes à andalousite de Glomel, les gneiss de
Plénée-Jugon, les migmatites du massif de Saint-Malo, les
amphibolites d'Yffiniac ; les roches magmatiques avec les différents
granites (granite rose de Ploumanac'h, granite à deux micas
de Quily, granites beiges de Languédias, Mégrit, granite
clair de Bobital, granite à cordiérite de Huelgoat, granite
bleu de Lanhélin, granite porphyroïde de Moncontour, …),
le gabbro de Saint-Quay-Portrieux, les dolérites de la Côte
d'Emeraude
|
|
|
|
|
| .
ETAPES GEOLOGIQUES :
(Tableaux
servant de points de repère)
|
|
|
|
|
|
|
PRECAMBRIEN
|
|
|
|
|
| -4,6
milliards d’années:
|
Formation
de la terre
|
|
| -3,8
milliards d’années :
|
Apparition
des plus vieilles roches terrestres connues
|
| -3,
5 milliards d’années :
|
Apparition
des cellules procaryotes
|
| -2
milliards d’années :
|
Apparition
des plus vieilles roches en France
(Gneiss
icartien de Trébeurden & Port-Béni en Pleubian)
|
| -1,
5
milliards d’années :
|
Apparition
des cellules eucaryotes
|
| -700
millions d’années :
|
Apparition
des algues
|
|
| -640
millions d’années :
|
La
région de Plestin les Grèves/ Locquémeau/ Lannion/
Tréguier/Paimpol
fait partie d’une zone volcanique intense liée à
l’enfoncement d’une plaque océanographique.
|
|
|
| -620
à 600 millions
d’années :
|
Dépôts
vaseux sous marins, de grande ampleur, donnant les schistes de
Saint-Lô, ou schistes briovériens qui constituent d’énormes
affleurements rocheux dans le sud et l’est du département
des Côtes d’Armor -région de Lamballe, Loudéac,
Merdrignac, Broons (Rochereuil) ,
Evran…
|
|
|
|
|
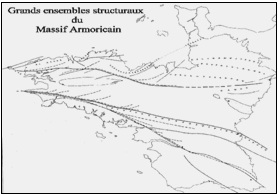
|
|
|
ERE
PRIMAIRE
|
|
|
|
|
| CAMBRIEN
: |
|
|
|
|
|
| -580
à 530 millions d’années :
|
A
la fin du Précambrien surgissent de hautes montagnes, c’est
l’orogenèse cadomienne. Plissement et métamorphisme des
schistes briovériens, formation des ortho gneiss de Lamballe,
des massifs granitiques de Perros-Guirec/ Bréhat/ Guitté
|
| -530
millions d’années :
|
au
début de l’ère primaire la vie n’existe qu’au fond des
mers sous formes d’êtres unicellulaires, les distensions liées
à la fin de l’édification des montagnes cadomiennes, entraînent
des manifestations de volcanisme aérien explosifs (baie
de Paimpol)
|
|
Apparition
des mollusques tribolites
|
|
|
|
|
| ORDOVICIEN :
|
|
|
|
|
|
| -480-470
millions d’années :
|
à
l’Ordovicien, la vie n’existe toujours pas, vers la fin de
cette période, la phase de transgression
marine sur le continent cadomien produit des vases
noires à faune marine qui donneront les schistes. Apparition
des poissons
|
|
|
|
| SIBERIEN :
|
|
|
|
|
|
| -420
à 400 millions d’années :
|
Mise
en place sur les terres émergées de grands filons de dolérite
au niveau des fissures de l’écorce terrestre
|
|
Apparition
des animaux terrestres
|
|
|
|
|
|

La
fontaine aux Pies à Mementü
Elle présente la particularité d’être toujours
alimentée en eau.
|
|
|
|
|
| DEVONIEN : |
|
|
|
|
|
| -400
à 360 millions d’années :
|
Au
Dévonien la vie végétale se développe sur terre, entraînant
la formation des sols, aidant à réduire l’érosion .
Au Dévonien supérieur,
il semble que l’ensemble des terres soit émergé.
|
|
Apparition
des amphibiens et des insectes
|
|
|
|
| CARBONIFERE : |
|
|
|
|
|
| -350
à 280 millions d’années :
|
Naissance
d’une nouvelle chaîne de montagne. C’est l’orogenèse
hercynienne qui s’accompagne d’un plissement
des formations
sédimentaires antérieures
(
rocher de Mémentü)
|
|
Des
manifestations volcaniques accompagnent les mouvements
tectoniques. Pris en tenaille entre Bretagne Nord et Bretagne
Sud, les sédiments sont plissés et forment un vaste
synclionrium médian, à
travers toute la Bretagne.
|
|
Apparition
des reptiles et des forêts de fougères
|
|
|
|
| -330
millions d’années :
|
Massif
de Plouaret/Trédez
|
|
|
|
| -310
millions d’années :
|
Massif
de Moncontour
|
|
|
|
|
| -300
millions d’années :
|
Massif
de Bobital |
|
|
Massif
de Quintin
|
|
|
|
|
| PERNIEN : |
Apparition
des forêts de conifères
|
|
|
|
|
ERE
SECONDAIRE
|
|
|
|
|
| TRIAS : |
|
|
|
|
|
| 250
millions d’années :
|
Apparition
des dinosaures et des mammifères
|
|
|
|
| JURASSIQUE : |
|
|
|
|
|
| 195
millions d’années :
|
Il
n’y a qu’un seul continent : |
|
|
la
Pangée, mais
la dérive des continents
va fragmenter cette masse peu à peu.
|
|
|
|
|
Apparition
des oiseaux et des plantes à fleurs
|
|
|
|
| CRETACES : |
|
|
|
|
|
| 135
millions d’années :
|
Apparition
des primates et des marsupiaux |
|
|
|
|
ERE
TERTIAIRE
|
|
|
|
|
| A
l’ère Tertiaire, la région subi des efforts
tectoniques très importants, il en résulte des fossés
comme les cuvettes de Plénée-Jugon & Sévignac.
|
|
|
|
| PALEOCENE |
|
|
|
|
|
| 65
millions d’années
|
|
|
|
|
|
| EOCENE |
|
|
|
|
|
| 55
millions d’années |
|
|
|
|
|
| OLIGOCENE |
|
|
|
|
|
| 40
millions d’années
|
|
|
|
|
|
| MIOCENE
|
|
|
|
|
|
| 25
millions
d’années
|
La
dérive des continents se poursuit, notre contrée connaît
alors un climat subtropical comparable à celui de la Mer
Rouge.
Au cours
de cette période dite du Miocène, un bras de mer peu profond
séparait notre péninsule de la basse Normandie et de l’Anjou
et inondait les vallées de la Vilaine et de la Rance: la mer
des faluns. De nombreux fossiles ont été découverts dans la
région du Quiou (dents de requins, lamantins, phoques, os de
primates, coraux, pollens de palmiers, séquoias…)
|
|
|
| PLIOCENE |
|
|
|
|
|
| 7
millions d’années |
apparition
de Toumaï, 1er hominidé connu.
|
|
|
|
|
| 5,3
millions d’années
|
Apparition
des mammifères des herbivores et des carnivores |
|
|
|
|
ERE
QUATERNAIRE
|
|
|
|
|
|
| L’ère
quaternaire fut marquée par les grandes glaciations |
|
|
|
|
| 3,5
millions d’années : |
Apparition
des êtres humains :
|
|
|
|
|
|
Lucy
en Éthiopie, notamment dans la vallée de l'Afar
&
Abel, dans le désert du Tchad
|
|
|
|
| PLECSTOCENE |
|
|
|
|
|
|
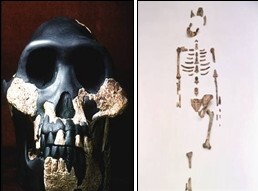
|
|
|
|
|
| Australopitèque
d'Australopithecus afarensis, une des plus anciennes espèces
d'hominidés, est âgé d'environ quatre millions d'années.
Il possédait des caractéristiques communes avec l’homme
moderne, mais aussi avec les singes actuels . A droite Lucy
|
|
|
|
| En
Ethiopie, à environ quatre cents kilomètres au Nord-Est
d’Addis-Abeba, à Dikika, les berges du fleuve Awash, dont
les boues l’ont protégée notamment des charognards Lucy,
trouvée en 1974, était presque en face.
Son époque ? 150 000 ans plus vieille que Lucy, ce qui
donne 3,32 millions d’années.
Son âge ? 20 ans,
conclut l’étude des mâchoires et de la dentition (des
dents de lait ont été retrouvées), avec tomographie assistée
par ordinateur.
Cause de la mort ? L’état des
os inspire l’hypothèse que la fillette est morte noyée,
probablament lors d’une inondation.
Sa famille ? Australopithecus
afarensis, indique l’équipe internationale de découvreurs
dirigée par l’Ethiopien Zeresenay Alemseged, de l’Institut
Mack Planck de Leipzig.
La quasi-totalité des os ayant pu être
rassemblée, un portrait de la fillette peut être reconstitué :
des mains « longues et
recourbées », des doigts « longs et incurvés »,
un crâne (entier) de 330 cm3, une taille de quarante centimètres.
Il reste encore à dégager
quelques parties du squelette de la gangue de sédiments.
Mi-fille, mi-singe ? "La partie inférieure du corps
- le pied, le tibia, le fémur - nous montre clairement que
cette espèce était une créature marchant debout", note
Zeresenay Alemseged.Bipède, l’enfant présente aussi des
caractères propres aux grands singes grimpeurs : la
morphologie des mains et des bras est adaptée aux déplacements
dans les arbres.
Comme la découverte a déclenché un grand
enthousiasme dans la communauté scientifique ("Cette
fillette représente le squelette d’enfant le plus ancien et
le plus complet jamais découvert dans l’histoire de la paléoanthropologie",
a déclaré le Pr Zeresenay Alemseged), le squelette a été
baptisé Selam, soit paix en amharique, langue
officielle de l’Ethiopie. Le nom de Lucy avait bien été
trouvé dans le ciel des Beatles.
|
|
|
|
| Australopithecus
anamensis, qui vécut
au Kenya il y a 4,2 millions d’années jusqu’à il y a 3,9
millions d’années ;
|
|
|
|
| Australopithecus
afarensis, espèce à laquelle appartient Lucy, ayant vécu
il y a 3,9 millions d’années jusqu’à il y a 2,9 millions
d’années ; |
|
|
|
| Australopithecus
bahrelghazali, dont on
pense qu’il a vécu en Afrique centrale il y a 3,5 millions
d’années jusqu’à il y a 3 millions d’années ;
|
|
|
|
| Australopithecus
aethiopicus, découvert
au lac Turkana (Kenya) et datant de 2,9 à 2,6 millions
d’années ; |
|
|
|
| Australopithecus
africanus, originaire
du sud de l’Afrique et vieux de 3 à 2,5 millions d’années
;
|
|
|
|
| Australopithecus
boisei, ayant vécu en
Afrique orientale il y a 2,5 millions d’années jusqu’à
1,5 million d’années ; |
|
|
|
| Australopithecus
robustus, qui a occupé
l’Afrique du Sud il y a 2 millions d’années jusqu’à il
y a 1,5 million d’années |
|
|
|
| LE
MESOLITHIQUE |
|
|
|
|
|
| 10.000
ans : au mésolithique se produit le premier réchauffement
de la fin de la période glaciaire, appelé oscillation d’Alleröd.
Peu à peu s’installe un climat plus tempéré. La forêt se
développe. La faune froide (mammouth, renne, bouquetin, etc.)
se raréfie tandis que se multiplie la faune tempérée
(sanglier, cerf, etc.) ; le mésolithique traduit
l’adaptation à ce nouvel environnement. Grottes peintes. |
|
|
|
|
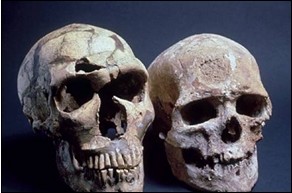
|
|
|
Homme
de Néandertal, vivait au mésolithique,
de 120 000 à 35 000 ans et s’est éteint sans
descendance (à gauche)
et homme moderne |
|
|
|
|
| PALEOLITHIQUE |
|
|
|
|
|
| 3
millions d’années à en 8000 av. J.-C. environ, emploi de
petits silex pointus ou tranchants. Apparition il y a environ
2 millions d’années de l’homo sapiens, dont fait partie
l’homme moderne. 15000
av. J.-C. à 9.000 : homme de Cro-Magnon
|
|
|
|
| LE
NEOLITHIQUE |
|
|
|
|
|
| 8000
av. J.-C. au Proche-Orient et 2000 av. J.-C, apparition de
l’agriculture. Monuments connus sous forme d’allées
couvertes, menhirs. (Ville
au Bourg). Apparition du
feu, il y a 450 000 ans, les plus anciens foyers datés
ont été découverts en Bretagne.
|
|
|
|
| L’AGE
DU BRONZE |
|
|
|
|
|
| 2.000
à 800 av. J.-C, de la métallurgie, notamment du bronze,
alliage de cuivre et d'étain, destiné à la fabrication
d'outils, d'armes, de bijoux et d'objets divers. Arrivée des
Gaulois en Europe. Monuments
connus les tumulus.
Les dolmens étaient généralement
recouverts de terre pour former des buttes artificielles, ou
tumulus. (Brondineuf)
|
|
|
|
| L’AGE
DE FER |
|
|
|
|
|
| 500
av. J.-C à 56 avant J-C (conquête
romaine)
|
|
|
|
|
| L’EMPIRE
GALLO-ROMAIN
|
|
|
|
|
|
| De
56 avant J-C aux environs 480 de notre ère (Chute
de Rome)
|
|
|
|
|

Le
site de Mementü
|
|
|
|
|
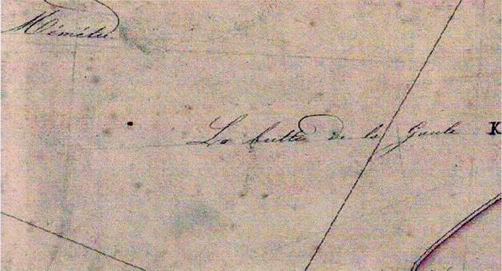
|
|