|
LES
DEFRICHEMENTS
Trois
grandes périodes de défrichement se sont succédé au Moyen
Âge.
La première remonte au VIe siècle ;
la deuxième, de
loin la plus importante, s’étale du XIe au XIIIe siècle ;
et la troisième s’étend de 1450 à 1500 environ, alors que
la Peste noire, la guerre de Cent Ans et les mauvaises récoltes
font déserter les sites défrichés.
Néanmoins, ces trois périodes
ont un caractère commun : elles sont déterminées par une
croissance démographique forte, une volonté politique bien
affirmée et une paix relative. Les défrichements sont
effectivement le fruit d’une volonté politique : celle de
seigneurs désireux de rentabiliser leur fief en
l’exploitant le plus possible. Si les seigneuries
monastiques cisterciennes et bénédictines ont joué souvent
un rôle non négligeable dans cette vaste entreprise, les
seigneurs laïques ont, eux
aussi, activement participé à ce mouvement avec, en
premier lieu, les rois de France.
Pour attirer les paysans,
ces seigneurs offrent aux défricheurs des franchises,
c’est-à-dire des réductions d’impôts ou des libertés
particulières. Les noms de Villefranche, Villeneuve ou
Bastides sont la trace de ces libertés locales. Les seigneurs
recrutent fort loin leurs nouveaux paysans : des Poitevins et
des Bretons viennent ainsi défricher la région de
l’Entre-deux-Mers, près de Bordeaux. Ces entreprises
profitent, à partir du XIe siècle, de la diffusion de la métallurgie
et du recours, dans les régions les plus riches, aux chevaux
de trait.
Ces améliorations permettent l’augmentation des
rendements et surtout l’allongement des sillons — donc
l’extension de fait des surfaces cultivées. Avec
l’introduction de franchises, les défrichements ont permis
au métayage et au salariat de se substituer peu à peu au
système initial des corvées, survivance pénible mais moins
systématique qu’au haut Moyen Âge.
Les défrichements ont
aussi pour conséquence l’augmentation des revenus de la
terre et, au-delà, l’enrichissement général des pays
concernés. La troisième période de défrichement permet
aussi à une nouvelle élite de s’imposer : celle des
notables urbains tels les capitouls, ces magistrats
toulousains qui profitent de la crise de la noblesse
traditionnelle pour se saisir de seigneuries où ils
organisent systématiquement l’exploitation du pastel.
Cependant, l’accroissement de la population se poursuit à
un rythme plus rapide que celui des rendements, selon le
principe des rendements décroissants énoncé par l’économiste
Malthus au XVIIIe siècle.
Aussi les défrichements s’arrêtent-ils
lorsque les terres défrichables ne sont plus suffisamment
rentables pour subvenir aux besoins des défricheurs : ces
terres pauvres (landes, terres inondables du pays de Caux ou
hautes terres du Massif central) sont alors délaissées. Le
phénomène de la surpopulation française, du Languedoc à
l’Île-de-France (Emmanuel Le Roy Ladurie a étudié la
surpopulation du Languedoc, Jean Jacquart, celle de l’Île-de-France),
explique en partie la crise profonde qui touche la France à
partir des années 1550-1560.
Au total, ces grands défrichements
constituent l’évolution la plus importante de l’économie
agricole durant le Moyen Âge : ils sont la condition des périodes
de prospérité médiévale, ils entraînent de profondes
modifications des systèmes d’exploitation et des hiérarchies
sociales et économiques, et façonnent durablement le paysage
rural français.
À partir des années soixante, la toponymie,
la dendrologie et la photographie aérienne sont utilisées de
manière systématique pour compléter les informations géographiques
très lacunaires, fournies jusqu’alors par les seules
chroniques.
|
|
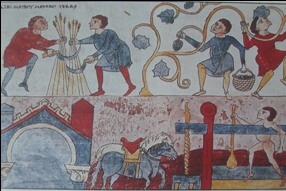
Les
diverses tâches du laboureur au Moyen-Âge

La Villeneuve
|