|
L’ALLEE
COUVERTE DE LA VILLE AU BOURG
Témoignage
des premières traces de civilisation à Rouillac, l’allée couverte
mise à jour à la fin du XIXème siècle et détruite après fouille en
1897 :
Voici le résumé
des fouilles qui y furent pratiquées :
« Appuyée
par l’extrémité nord au talus d’un chemin creux qui borde le
champs où se dresse le monument, il s’avance sur une longueur de 13 mètres,
normalement à ce talus, dans les terres labourables.
L’entrée de
l’allée est dirigée un peu à droite du clocher de Rouillac, en est
distante de 300 mètres environ.
Les 3 piliers extrêmes du Nord, un
transversal et deux latéraux, formant le fond de la chambre, n’ont
plus leur table de recouvrement, elle a été chavirée dans l’Ouest et
on la voit fichée en terre, elle est d’une longueur de 2, 40 mètres.
La seconde table mesure 2, 50 mètres X 2, 40 mètres et 1, 40 mètre
d’épaisseur.
La troisième table épaisse de 0, 80 mètre, est la
seule qui soit en place. Au fond, entre les piliers 1 & 1’, la
largeur est de 1, 43 mètre ; entre les piliers 2 & 2’, la
largeur est de 1, 20 mètre seulement.
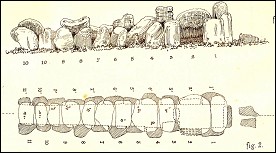
Allée
couverte à la Ville au Bourg
Le
mobilier funéraire :
a)
une grosse hache en diorite massive presque conique.
b)
un poignard en silex
jaune brun
g)
une molette en granit
h)
une moitié intérieure d’une hache en diorite
m)
une hache en diorite
n)
une hache en dia base
o)
une hache en dia base
p)
une hache en diorite
s)
une
molette en granit
 
Poignard
en silex & pointe de flèche du dolmen de Rouillac
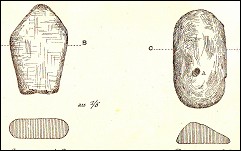
Molettes
en granit
|
|
LE
NÉOLITHIQUE
C'est le naturaliste et homme politique britannique
sir John Lubbock qui, en 1865, propose les termes paléolithique (du
grec palaios, « vieux », et lithos, « pierre ») et néolithique (de
neo, « nouveau ») pour désigner respectivement l'âge de la pierre
taillée et l'âge de la pierre polie. On utilise également les termes
« âge de la pierre ancienne » et « âge de la pierre nouvelle ».
Le
polissage marque une rupture technologique fondamentale entre les deux périodes.
En rendant les tranchants plus efficaces et plus résistants, le
polissage des outils en pierre a permis de généraliser les défrichages
(coupe du bois et extraction des racines) et de favoriser l’émergence
de l’agriculture. Par l’essor démographique qui en est résulté,
le néolithique a été à l’origine des grandes migrations. Le néolithique
a toujours été associé aux origines de l'agriculture, à la sédentarisation
des peuples sur les terres cultivées, et à l'utilisation de la poterie
(voir céramique) et des outils de pierre polie. Ce terme reste utilisé
pour tout l'Ancien Monde, avec des dates qui varient entre 8000 av.
J.-C. au Proche-Orient et 2000 av. J.-C., date à laquelle a été adoptée
la technologie du cuivre ou du bronze dans le nord de l'Europe.
Il en
est de même pour l’Afrique où la céramique a fait son apparition à
la même époque, et d’une manière autonome, dans le massif de l’Aïr
(Sahara), mais a perduré longtemps sur le continent parallèlement à
la métallurgie du fer.
La culture des céréales et l'élevage de
bovins, d’ovins, de caprins et de porcins, issus d’un long processus
de sélection et de domestication, ont permis un fort accroissement de
la population et ont imposé la sédentarisation.
Le néolithique voit
ainsi l'émergence des premiers villages, aux maisons construites avec
les matériaux locaux : briques de terre séchée au Proche-Orient (Çatal
Höyük, en Turquie), pierre brute (Fontbouise, dans le Gard) et rondins
de bois isolés avec de la terre dans le centre et l'ouest de l'Europe,
par exemple.
À Jéricho, le néolithique précéramique coïncide avec
la construction de gigantesques enceintes de pierre. Un des villages néolithiques
les plus représentatifs est celui de Skara Brae (de 2400 à 1800 av.
J.-C. environ), dans les îles Orcades, dont les maisons, et même les
meubles (lits, armoires et commodes), sont construits en plaques de
pierre.
Un important déboisement a été entrepris à la même époque,
comme en témoignent les nombreuses maisons en bois, de plus d'une
dizaine de mètres de long, construites en Europe avec de longs troncs
d’arbres. On a découvert dans l'un de ces sites, à Kückhoven dans
le nord-ouest de l'Allemagne, le plus ancien puits du monde, antérieur
à 5000 av. J.-C., consolidé avec de grandes plaques de bois.
Le néolithique
voit également l'apparition de passerelles en rondins permettant de
circuler au-dessus des marécages comme en Angleterre, et de villages
aux maisons construites avec des pieux de bois plantés en terre sur les
rives des lacs alpins, comme à Charavines, dans l’Isère (voir
Palafitte).
En un sens, la poterie est à l’origine de la
cuisine. La
poterie néolithique était souvent richement décorée de motifs
incrustés avant cuisson au moyen de divers objets (épis de céréales,
tige végétale), pour permettre une meilleure préhension. Les autres
objets en terre cuite (figurines votives, jouets) étaient souvent
peints avec des ocres de différents tons.
La très grande variété des
formes et des décors, ainsi que la qualité et la provenance des
argiles utilisées, permettent de déterminer des faciès culturels dont
la datation est ensuite effectuée par thermoluminescence. Les monuments
mégalithiques (du grec, signifiant « grande pierre ») font également
leur apparition au néolithique et se développent jusqu’à l’âge
du bronze.
Ceux d'Europe de l'Ouest sont les plus connus, avec les
immenses cercles de pierres de Grande-Bretagne (Stonehenge et Avebury) ;
les menhirs ou pierres levées, souvent isolés mais présents par
milliers sur le site de Carnac en Bretagne ; les « statues-menhirs »
anthropomorphes et les immenses tombes mégalithiques disséminées de
la Scandinavie au Portugal. La plupart de ces tombes, comme celles de
New Grange et Knowth en Irlande, ou Gavr'inis en Bretagne, sont
abondamment décorées de motifs incrustés dans la pierre : spirales,
diamants et même des haches. Certaines sépultures en Espagne et au
Portugal étaient peintes à l'intérieur.
L'astronomie a joué un rôle
important dans la conception et l'orientation de certains de ces
monuments ; Stonehenge par exemple, est aligné dans l'axe du Soleil en
été. Si les mégalithes de certains monuments européens présentent
des proportions gigantesques, un des ensembles les plus spectaculaires
de cette culture mégalithique se trouve sur l'île de Pâques, où une
civilisation de type néolithique a édifié, entre 500 av. J.-C. et
environ 1600, des centaines de plates-formes imposantes, les ahu.
Ces
dernières sont composées d'énormes blocs de pierre, sur lesquelles
sont érigées d'imposantes statues de pierre, ou moai. Tout d’abord
sculptées dans le tuf volcanique au moyen de marteaux de basalte, ces
statues ont été vraisemblablement transportées sur des rondins de
bois, sur des kilomètres, jusqu'aux plates-formes.
Le travail nécessaire
à la réalisation de ce gigantesque ensemble mégalithique témoigne de
l'ingéniosité et des remarquables capacités de ce peuple disposant
pour toute technologie de simples outils de pierre et de matériaux
organiques.
Les exploitations minières apparaissent également au néolithique.
L'obsidienne (verre volcanique), très employée au mésolithique,
provenait des îles de la Méditerranée et faisait l’objet d’un
commerce étendu. Il en est de même du poisson et des coquillages,
commercialisés séchés ou fumés, comme en témoignent les très
nombreux amas coquilliers
|
|
LES ALLEES COUVERTES
Les mégalithes d'Europe occidentale ont été construits entre 4500 et
1800 av. J.-C., au cours de la période néolithique et pendant une
partie de l'âge du bronze.
Les îles Britanniques, l'ouest et le
centre-ouest de la France, la Belgique, le nord de l'Allemagne, la
Scandinavie, l'Espagne, le Portugal, les îles méditerranéennes (Baléares,
Malte), l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la Crimée, le Caucase, les
hauts plateaux iraniens, le plateau du Dekkan, la Birmanie, le Japon et
les îles du Pacifique Sud, en particulier l'île de Pâques, ainsi que
l’Afrique subsaharienne, comptent parmi les régions les plus riches
en mégalithes.
Il existe
trois types de sépultures mégalithiques : les dolmens simples, les
dolmens à couloir, et les allées couvertes qui sont des chambres
rectangulaires allongées constituant, en fait, une suite de dolmens
placés les uns contre les autres.
|
|

Les
restes de l’allée couverte |