|
visite de
Bourgneuf par les Cousamis
le
Maquis et les Résistants
les
Loups
|
|
|
|
(160
mètres d’altitude)
-peut
être formé avec la racine bretonne : bod
(Buisson-bois)
|
|

|
|
Familles
présentes à Bougueneuf
|
|
-Trillard
1670-1780
-Rouvrais
1680-1780
-Lorêt
1690-1710
(Le Bourg Neuf)
-Douais
1690-1730 (métairie de
Bourgeneuf)
-Lescouët
1690-1700 (le Bourgneuf)
-Duval
1690-1710 (le Bourgneuf)
-Hamonic
1690-1700
-Legac
1720-1730
-Reboux
1720-1730
-Duchesne
1730-1750 (métairie de Bougueneuf)
-Hervé
1740-1750
-Rochard
1730-1750 (Bois Bougueneuf)
|
|
-Perrin
1740-1750
(métairie de Bougueneuf)
-Paulmier
1740-1750 (métairie de Bougueneuf)
-Lerin
1740-1750
-Richard
1750-1790 (Métairie de Bougnay)
-Denouel
1740-1750 (boisillier au Bois de Bougueneuf)
-Brisourier
1740-1750 (Bois Bougueneuf)
-Cadec
1740-1750 (org.Tréguier,
Bois de Bougueneuf) *
-Morin
1750-1790
(métairie de Bougueneuf)
-Lenée
1750-1760 (métairie
de Bougueneuf)
-Guérin
1760-1770
-Lemée
1760-1770 (métairie
de Bougueneuf)
-Brillault
1770-1780 (Bougneuf)
|
|
|
|
|

Le bois de
Bougueneuf
|
|
|
|
|
|
LES
MOTTES CASTRALES DE BOUGUENEUF
|
|
|
|
|
|
Anciennement
Bougueneac dans une montre de 1475,
le lieu semble avoir une origine gallo-romaine.
Un
enclos datant probablement de l’Age du Fer a été mis à
jour en 2003 lors d’une prospection aérienne du centre archéologique
d’Alet.
C’est très certainement à l’époque féodale,
aux environs de l’an mil que l’endroit fut choisi comme
site stratégique afin d’y aménager des défenses de types
mottes castrales.
Une
motte castrale était avant tout un ouvrage militaire, et au
vu des techniques encore rudimentaires de la guerre au
XIè siècle, la
composition d’un
tel site se résumait à l’emploi de bois ce n’est qu’un
peu plus tard qu’on incorpora de la pierre à ce type
d’ouvrage. Contrairement à la tradition romantique — et
anachronique — qui veut que les châteaux à motte aient été
édifiés à l’initiative de chevaliers soucieux d’offrir
aux manants une protection contre les attaques des Sarrasins
ou des Normands, ils sont le plus souvent le résultat d’une
concession faite par un suzerain local ou national à un
vassal.
Tout laisse donc penser qu’un vassal des seigneurs
de Dinan ait possédé ici une défense. La motte servant
aussi de résidence à ses possesseurs, on peu aisément
imaginr l’exiguïté de l’espace réservé au seigneur et
à sa famille qui habitait le premier étage, le second étage
étant réservé à la défense, et le rez de chaussée
servant de magasins et de celliers. La forme de Bourgneuf est
également à rapprocher de Villeneuve, ces lieux furent défrichés
à l’époque féodale.
On
connaissait déjà l’une de ces mottes située à l’extrémité
orientale, dans l’angle nord, désignée la Butte
Laurent***. Cette première motte était décrite comme une
enceinte circulaire formée par un fossé entourant une butte
un peu aplanie. D’une hauteur de 14 mètres, elle est entourée
d’une première enceinte d’une circonférence de 140 mètres,
une seconde enceinte en partie disparue mesure le double. Au-delà
de cette seconde enceinte, dans l’angle nord on devine la
barbacane. On aperçoit sur le à l’angle nord-ouest du
rempart un éboulis de matériaux, la tradition atteste
qu’une partie de l’actuel manoir proviendrait de cette
motte.
L’ensemble dû être
utilisé jusqu’aux environs du XIVème siècle. Cependant,
lors de prospections aériennes effectuées le 13 juillet
2002 par le Centre Archéologique d’Aleth,
une seconde motte fut découverte au milieu d’un étang,
situé dans l’angle sud du Bois de Bourgneuf, ce qui laisse
supposer l’importance de
l’endroit.
On
ne sait pas en revanche vers quelle période ces sites furent
abandonnés.
***La
tradition prétend
que sur cette motte s’élevait autrefois le château des
Beaumanoir.
|
|
L’une
des « mottes castrales » de Bougneuf au centre
d’un étang, en réalité un îlot aménagé
artificiellement lors de la mise en eau du site

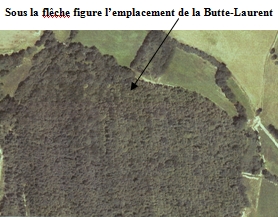
|
|
|
|
|
LA
MOTTE CASTRALE
Peu
nombreux encore, aux environ de l'An Mil, les "châteaux"
primitifs de bois et de terre vont se multiplier, accompagnant
la "révolution cistercienne" et l'intensification
du défrichement des campagnes et la croissance démographique.
Les maîtres des lieux imposent leur autorité en confortant
les prérogatives qui leur ont été attribuées par les
vestiges d'un pouvoir central très éloigné ... ou qu'ils se
sont attribuées par la force, la ruse ou les alliances.
Ces
fortifications, qui traduisent de façon tangible les règles
de la féodalité naissante, outre leur fonction défensive,
vont devenir des centres de gouvernement et d'administration,
sans être de véritables chateaux, qu'elles préfigurent
cependant.
De plan vaguement circulaire, pour tenir compte du
relief, les enceintes castrales vont couvrir l'Europe
occidentale de la fin du IX° siècle au XII° siècle.
Ce
sont des plates-formes de 10 à 100 mètres de diamètre,
parfois légèrement surélevées. Elles sont constituées
d'un habitat permanent fait de bois et de torchis. Ces espaces
sont cernés d'un fossé profond de 3 à 4 mètres, assez
rarement en eau, protégé par un talus fait de la terre qui
provient tout simplement du creusement du fossé, armé de
palis et de fascines. Une passerelle escamotable ou un passage
permanent renforcés d'un appareil défensif permettent l'accès.
La fin du XI° siècle, voit apparaître une forme castrale
plus performante : le château sur motte. De construction aisée,
ces bâtisses de bois et de terre essaimeront jusqu'au début
du XIII° siècle, bravant souvent l'autorité royale ou
ducale.
En principe, seul le roi ou son représentant, peut
accorder le droit de fortifier.
Nombre de petits féodaux ont
profité de la faiblesse du pouvoir royal pour passer outre à
cette autorisation.
|
|
Reconstitution
d’une motte castrale
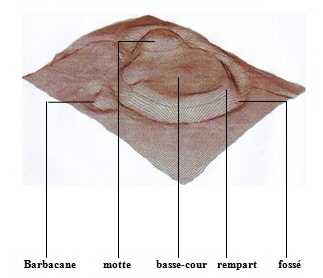
Motte :
colline artificielle de terre de forme tronconique, portant
une tour souvent accompagnée d’une palissade
Basse-cour :
placée en position inférieure par rapport à la motte, elle
en est le complément, souvent délimitée par une enceinte,
elle contient des bâtiments résidentiels et des bâtiments
de service
Rempart : Il est
constitué d’une levée de terre, maintenue
par du bois ou un mur de soutènement. Il porte souvent
une palissade ou un chemin de ronde
Fossé : un fossé sec isole la
motte & la basse-cour qu’il isole et protège
Barbacane :
c’est un ouvrage avancé, placé face à une entrée au-delà
du fossé

|
|
|
|
|
|

La Butte
Laurent
|
|
|
|
|
|

La Butte
Laurent
|
|

La deuxième
enceinte
|
|
|
|
|
|

Le rempart
et le fossé
|
|

Le flan Est
de la butte
|
|
|
|
|
LE
MANOIR DE BOURGNEUF
Relativement
transformé, ce manoir devait en partie dater du XVe siècle.
Un double porche devait en permettre l’accès,
cependant, il a été supprimé afin de laisser place
à de simples ouvertures. En revanche, un fenestrage a été
conservé à droite de ce double porche.
|
|

Le
manoir de Bourgneuf
|
|
|
|
|
|

Fenestrage
du début XVème siècle incorporé dans le manoir de Bourgneuf
|
|

À
Bougneuf, un
vieux puits est
incorporé dans une remise,
À droite on observe une remarquable auge
|
|
|
|
|
|
La
famille Le Berruyer :
La
première famille mentionnée à Bourgneuf, c’est la famille
Le Berruyer qui portait pour armes
« D’azur à trois pots d’argent » et
avait pour devise
Meliora sequntur
Cette
famille était présente à Bourgneuf dès
1428, avec Jean
Le Berruyer. En 1449, Amice Le Berruyer est cité présent à
la Ville Billy, autre village de la paroisse de Sévignac.
Un
certain Guillaume Rouxel décédé en 1435, était
marié à PerrotteLe Berruyer de la Maison du Margaro.
-Jehan
Le Berruyer, noble homme à Bougueneac, d’après la montre
nobiliaire de 1475.
Jean
Le Berruyer marié
vers 1513 à Jeanne Hudelor eut pour héritier Robin époux de
Jeanne Gaude. Vers 1569, Jean Le Berruyer fils de
Robin épousa Marguerite Volance de Plénée, héritière de
la terre du Tertre
Volance et de la Barbottais en Plénée, il eut pour fils François
Le Berruyer qui est
dit Sieur du Tertre
Volance. En 1691, la terre du Tertre Volance était encore aux
mains d’un certain Jean Le Berruyer. Pour autant rien
n’atteste que cette famille était encore présente à
Bourgneuf vers cette période. La famille Hingant succéda
semble-t-il à la famille Le Berruyer au manoir de Bourgneuf.
|
|

Armes
Le Berruyer
|
|
|
|
|
|

Armes
Hingant

Armes
du Rocher
|
|
La
famille Hingant :
La
famille Hingant, dont les armes étaient « de gueules à
la fasce d’or accompagné de quatre billettes de même en
chef, et trois en pointe, posée 2 et
1 » comptait
pour ancêtre Geoffroi, chevalier, de la paroisse de Plestan,
mentionné dans une charte de Boquen en 1292. Olivier Hingant,
fils puîné de cette famille établie au château du Hac au
Quiou, ratifia le traité de Guérande en 1381, il épousa
Jeanne de la Tremblaye. Alain,
leur fils épousa Françoise de Quérouart. Les deux générations
suivantes comptaient Robert Hingant époux de Marguerite
Brillet et Jean Hingant époux de Gillette Guedé.
De
l’union de Jean Hingant & Gillette Guedé naquirent deux
fils : Jean, évoqué ci-dessous et Pierre évoqué à
l’article de Quihériac.
Jean
Hingant, se maria en 1606 avec Marguerite Bouessel, dame de La
Ville-Bouchart, fille de Pierre & Julienne Hattes. Ils
sont cités dans
le registre des baptêmes à Sévignac à deux reprises :
Ecuyer Jean Hingant et son épouse Marguerite Bouexel, sieur
et dame du Bourneuf, parents
d’un fille prénommé
Françoise née le 15 décembre 1608, l’enfant a
pour parrain
missire Jean Grignart, et pour marraine Delle Françoise
Chassault, dame de Launay-Chausanay . François Hingant,
fils de écuyer Jean Hingant et Marguerite Bouessel, fut
baptisé le 8 août 1610, en présence de écuyer François Glé,
sieur du Parga et Delle Guillemette Lelevroux, dame de l’Argentaye.
Deux autres enfants issus de Jean Hingant et Marguerite
Bouessel verrons le jour, l’un prénommé Jean est titré
sieur de la Tremblaye, un second fils prénommé Mathurin est
donné sieur de St Maur Titré
sieur de la Tremblaye, Jean Hingant épousera en 1647 Aliénor
deCleux. Joseph
leur fils
sera seigneur
de Bourgneuf. C’est
la famille du Rocher-Parga (voir
aussi le Plessix-Gauteron)
qui possédait Bougueneuf à la veille de la Révolution. Après,
le domaine de
Bourgneuf fera partie du domaine de Limoëlan.
|
|
|
|
|
LA
FEODALITE
Les rois
carolingiens du IXe siècle, en déléguant leurs pouvoirs aux
ducs et aux marquis pour conduire les hommes libres à la
guerre, et aux comtes pour présider les assemblées de
justice, utilisent les premiers ces liens vassaliques de dévouement
personnel. Ils transforment alors en vassaux les représentants
du ban royal dans les provinces, en exigeant un engagement de
fidélité exclusive, en échange des terres jusqu’ici perçues
comme simple rétribution.
De même, ils poussent les membres
des noblesses locales à se lier de la même manière aux
comtes. Tout un réseau de dévouements individuels se tisse
progressivement et remplace les obligations publiques. Cette
politique se pérennise, puisque le souverain ne peut refuser
à l’un des héritiers d’une délégation royale de
reprendre la charge paternelle.
C’est ainsi que s’établissent
des lignages comtaux et que se créent des principautés
autonomes au Xe siècle. Puis, à leur tour, les comtes se détachent
des ducs avant que ne se créent une multitude de cellules indépendants.
Autour de l’an mil, les maîtres des principales
forteresses, soutenus par leurs compagnies vassaliques,
cessent de se réunir autour du comte et s’approprient le
pouvoir de commander et de punir les populations villageoises.
Le droit de commander et de punir se trouve désormais
distribué en un grand nombre de territoires minuscules. Les
premiers châteaux furent élevés en Europe à la fin du IXe
siècle. Leur apparition coïncide avec l'affaiblissement du
pouvoir central et la lutte entre les premiers seigneurs féodaux
pour délimiter leur territoire (voir Féodalité).
Très
vite, le château cristallisa autour de sa position dominante
et de ses éléments militaires, effectifs ou purement
symboliques, la puissance du seigneur et son contrôle sur la
région environnante et sur ses habitants.
Le château pouvait
être un retranchement militaire, en particulier au Moyen Âge,
mais il était surtout un lieu de pouvoir administratif et
judiciaire.
|
| « Marie
Cadec, 18 jours, fille de Marie Cadec , décédée le
18.3.1747 ; les témoins sont : la mère, Jeanne
Michel, Marie Boche, Guillemette Herpé, tous travaillant
dans
le dit bois
« de Bougueneuf »
|
|

Boisilliers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le Maquis et les Résistants de Bourgneuf
les Loups
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|